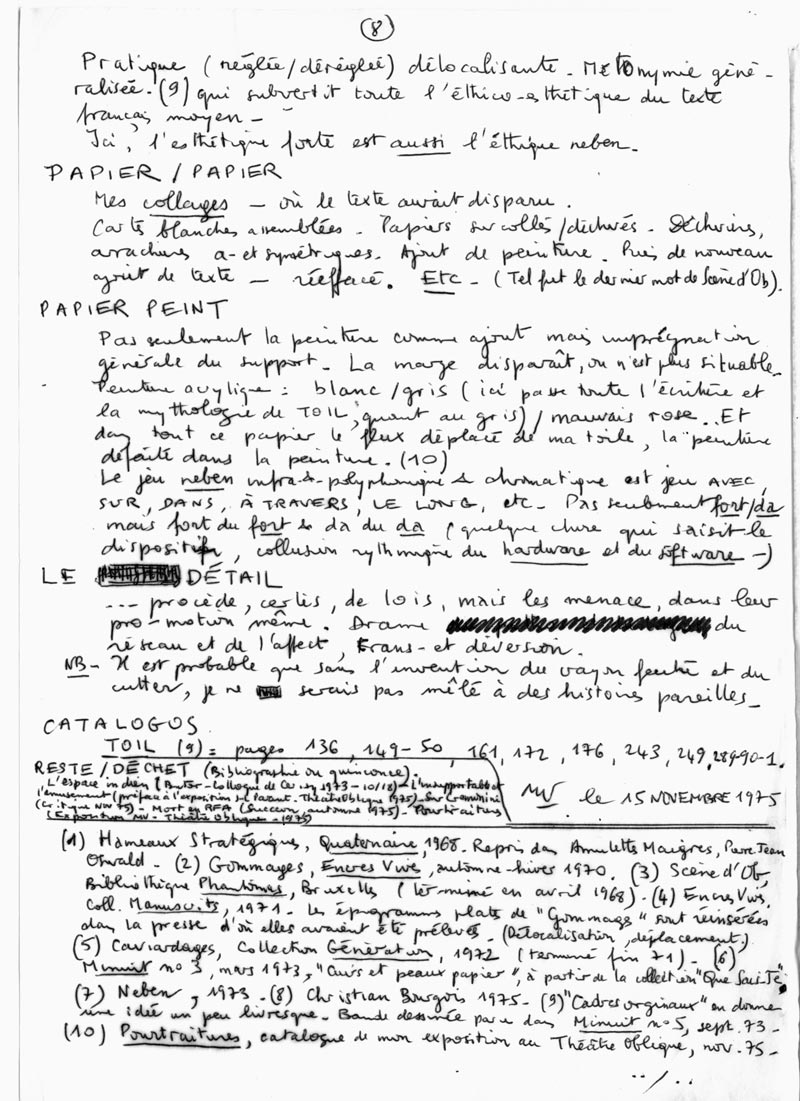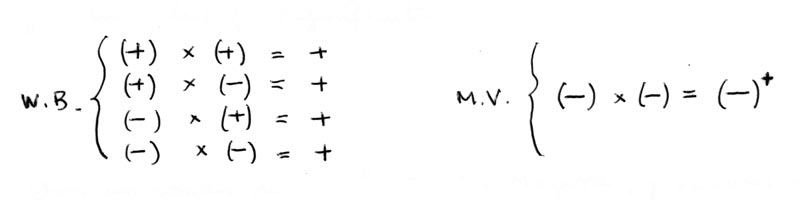
Transcription Christiane Monier
Relecture Marie-Valentine Martin, L.L. de Mars
NE PAS EN FAIRE UNE PIPE (ET SE TAILLER)
Texte inédit, devant probablement le rester : il s'agit sans doute ici des notes de 1975 auxquelles M.V. fait allusion dans une lettre à Châtel dans laquelle M.V. écrit :
« JE VOUS DONNE, quand vous repasserez à Lorient, quelques notes de 75 rédigées plutôt comme pour moi-même aux autres, afin d'expliciter une «démarche». Ces notes, je n'ai jamais voulu qu'elles soient publiées, (elles faillirent l'être malgré moi un jour), elles sont à parcourir comme ça, en marge, vite. Je n'aime pas leur style. » Ce texte semble être une sorte de retour sur le long et passionnant Caviardages de 1972 en regard duquel il gagne à être lu.
« Vous attribuerez à votre pipe l’étrange faculté
de vous fumer »
Baudelaire
RETOURS, PERTES.
Une quinzaine de tracts (1971-1974) où quelques aperçus incisifs
sur ma claudication côtoient la considération prudhommesque. Par
détails et par côtés, j’ai rendu compte de ma petite traversée
des signes.
TAMPONS
Une quinzaine de tampons (1969-1975). Le premier: INSTITUTO / Échantillon
N°. Le dernier: Vachey déplace les guillemets.
DÉGOÛT POSITIF
D’abord le dégoût et l’impasse (lié au refus d’exceller
dans ce qui n’était plus que styles ancien puis moderne), le sentiment
d’une usure irrémédiable et son exploration radicale, le choix
de la mort contre la mort, le saut incongru, erratique. Dans la désertion,
je découvrai l’excès.
« ANTI-CITATION »
Au moment où j’incorporais (1),
dans ce qui était toujours ma poésie, de menus bouts de phrases
de Le Monde, qu’est-ce qu’on poétait ici ? (Sur fond et contexte
débandade / rebandage déclenché par Tel Quel).
En très gros : OO - une fausse poésie d’un faux quotidien. O -
le déjà Tel Quel provincialisé (déni d’une
poésie négative s’installant avec arrogance, très hégeliennement
(parodie triomphale nourrie du savoir) dans la vieille charogne. a) l’imagisme
bachelardien : illusoirement ouvert (bonne conscience phénoménologique).
b) les divers concrétismes dans le cercle de leur trouvaille. c) la beat-génération
revue et corrigée à la française par le post-surréel.
d) le petit dé de mes occupations connexes (pas grand-chose en somme),
un temps faible parmi tous ces temps forts: une espèce de pratique du
quelconque, de l’insignifiant.
Les petits bout de phrases chassèrent l’imagisme. Loin de nier les processus
symboliques, je les dégageais, transversalement.
« Gommages » (ou : Épigrammes plats, ou :
Effaçades. même texte) (2)
ne fut qu’un montage de prélèvements journalistiques. Je détruisais
une certaine métaphore, non pas l’image. Je déplaçais le
texte, entre la Réactivation et l’Avant-Garde.
SCÈNES D’OB
«Gommages» (effaçades), entrée dans la non-couleur,
sortie vers le neutre, c’était l‘antipode absolue de «Scène
d’Ob» (3), ce théâtre
de l’hyper imagisme (v. la page 158, «Quelques accessoires» ).
Dans la préface-tract à «Portrait de la France» (4)
je me défendais (un peu comiquement) de faire du «collage»
, ce mot étant connoté par toutes sortes de choses dont je me
détournais résolument.
Ce que «Gommages» renversait primairement, contradictoirement, c’était
le sens et la référence. Se découvrait, en mode mineur,
l’indiscernabilité du pathos et du logos, leur double jeu et leur jeu
double non seulement réglé mais aléatoire, historique et
sauvage, dans le formidable potentiel des déplacements infimes.
Moment d’écriture neutre, grise, faible, qui s’inscrivait en faux contre
et en porte-à-faux avec les diverses logomachies imagiste, critique,
imagiste-critique.
Pratique intertextuelle et figurale, sans Théorie.
PLUS MOINS
Cut-up, certes. Pas à la manière du grand W.B., plutôt dans
le non-intéressant, free mais pas funky, côté Cage peut-être.
J’appelais ça anti-citation : plus c’était insignifiant, plus
ça signifiait.
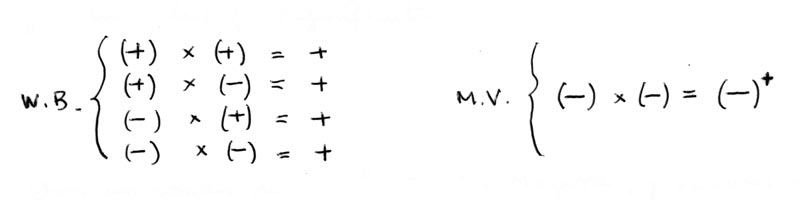
Dans un roman de 1968, «C’était à Mégara»,
j’écrivais assez innocemment : «Maintenant, il va falloir perdre».
Belle indécision (quoique allégorique) entre le négatif
et la dépense — comme s’il y avait eu à choisir !
Dans un texte dont j’ai eu rapidement honte (il doit se trouver dans les archives
de A.B.), j’écrivais — cependant — en 1964 qu’«en poésie
le signe moins n’existe pas.» (énorme paradoxe pour les habitués
du sexe / politique à la fenêtre — je revois quelques mines professorales
dubitatives. Aujourd’hui, le minimal (j’en faisais sans le savoir) fait partie
de leur culture).
LA PAGE NOIRE
Dans une page de journal je caviardais des phrases, des mots, des lettres, des
fragments de lettre, au crayon feutre noir. Au début de cette pratique,
une prédilection pour l’insignifiance. Caviardage en registre faible.
Puis la perversion devint intégrale : (+) perverti en (-), (-) perverti
en (+). La mise entre parenthèses introduisant au suspense, la censure
n’est pas saisie par son effet (point de vue politiste et esthético-moral)
mais comme constitutive.
Le texte mutilé fait jouer à fond non seulement la polysémie
(et, en creux, la polysyntaxie), non seulement un autre texte demandé
par les débris de plusieurs surfaces, mais les processus primaires et
ce que je nomme (gravement) principe d’incertitude ontologique (historico-logique).
N’importe quel point intenable (libidinal et sémiotique), toute
constellation de points, devenait complexe discursif-énergétique,
passage décisif-indécidable.
Si je me suis d’abord attaqué au texte journalistique, c’est à
cause de sa fausse neutralité, parce qu’il s’agit d’un texte faussement
hétérogène (et parfois aussi vraiment), d’un texte à
la fois stratégique et impur, d’un gris dangereux.
Par la suite, d’un texte monodique, (de type scientifique ou technique), je
fis un texte pornographique (5) (6).
Nouveau : l’utilisation esthétique (lire = non normative, non scéniquement
typographique) de l’encre et de la page déterminée par le choix
des fragments sémantiques (à laisser / à déterminer).
En ôtant encore, du texte caviardé, les mots subsistants (non pas
en les noircissant dans une seconde phrase mais en les remplaçant par
du blanc), il reste un dessin noir.
Ce dessin peut servir d’empreinte pour marquer des tablettes d’argile. J’ai
réalisé ainsi, avec une même empreinte (ndlr : dont l’origine
est une colonne de L’Express), plusieurs terres cuites identiques.
EVE GUNS LA LA LA *
C’est ce dessin qui m’amena à ce complexe graphique et scriptural plutôt
hot (côté +) qu’est La Langue Slave (7).
Ce livre est à la fois Scène d’Ob partout et des morceaux
possibles d’un palimpseste caché dans Gommages.
![]() Composition: Le Roman de
la momie (Flaubert) ; une page de L’Express ; Le verre (collection
Que Sais-Je, P.U.F.), avec texte et dessins technologiques ; Bandes
dessinées pour adulte ; le commentaire anglais d’un texte russe
absent ; une forme provenant d’un joint de moteur Renault (utilisé
comme pochoir) ; des traits de marker.
Composition: Le Roman de
la momie (Flaubert) ; une page de L’Express ; Le verre (collection
Que Sais-Je, P.U.F.), avec texte et dessins technologiques ; Bandes
dessinées pour adulte ; le commentaire anglais d’un texte russe
absent ; une forme provenant d’un joint de moteur Renault (utilisé
comme pochoir) ; des traits de marker.
![]() Ce texte, imprimé en offset,
à l’encre marron, a uniformisé l’hétérogénéité
du matériau (différents papiers, différentes couleurs d’encre).
Il se compose alors de 20 cartes (= 40 collages), 10 x 16 cm. Toutes les cartes
sont faites de bandes verticales juxtaposées, sauf en bas, une bande
horizontale, pseudo-commentaire (parodique).
Ce texte, imprimé en offset,
à l’encre marron, a uniformisé l’hétérogénéité
du matériau (différents papiers, différentes couleurs d’encre).
Il se compose alors de 20 cartes (= 40 collages), 10 x 16 cm. Toutes les cartes
sont faites de bandes verticales juxtaposées, sauf en bas, une bande
horizontale, pseudo-commentaire (parodique).
L’ordre de succession, le mode de répétition, la dimension des
prélèvements respectifs, varient d’une carte à l’autre.
Une forme toujours identique (phalloïde), mais située différemment
dans le format, confère à chaque carte un pseudo-point nodal alors
que les traits de caviardages renforcent le cut-up.
Il ne s’agit donc pas de poésie permutationnelle mais d’une contradiction
forte entre procédé et processus, mise en œuvre de quelque chose
qui « fait machine » (on sait désormais avec l’Anti-Œdipe,
que les machines « ne fonctionnent que détraquées »
), ce faire-machine excédant tout fonctionnement.
L’encre utilisé pour l’offset, ce fondu marron, est le consentement au
moyen — pour sa perte.
N.B. Je ne m’oppose pas à l’art permutationnel. Pourquoi (et d’ailleurs comment) m’y opposerais-je ? Mes collages donneront, seuls, la réponse.
NEUTRE MONSTRE
Ni l’un ni l’autre, l’un et l’autre, le neutre est à l'ordre théorique
ce que la monstruosité est à l’ordre politique. On ne sait plus
très bien si l’événement fait défaut ou s’il est
en trop. On est dans la folie des paramètres, la catastrophe, l’inouï.
Quand quelques vraisemblances impérieuses mais trop humaines font couac,
les effets incontrôlables, et le mouvement de l’étrange dessin
neben, étrange-ici, désignent le monstre neutre.
Comme en un caviardage, le déchet bouscule le reste, quelque chose de
mal connu se transforme et redessine. Entre l’arbitraire et l’aléa, le
crayon feutre maintient et efface, avec un haut et bas calcul, une irresponsabilité
scrupuleuse, la mémoire tranchant dans l’oubli, tranchée d’oubli.
Reste / déchet s’engendrent / se détruisent, matière même
du principe, principe de matière, errance de l’ordre.
VEDUTA & PSEUDO
Mes livres (cut-up tridimensionnel) ne mettent à jour, ne procèdent
d’aucune combinatoire : ils fixent un pseudo-fantasme, mais précisément
le pseudo du fantasme. Mes livres reconstituent-ils une scène singulière ?
Chaque livre, de format bien net, ressemble à un cadre, la succession
en profondeur des découpes pourrait n’être qu’une enfilade de vues.
Non, même pas en un sens parodique. De fausses perspectives n’apparaissent
que pour leur dissolution.
Qu’on abandonne le « pliage » et le « tassement »
rituels du « minuscule tombeau, certes, de l’âme »
(Mallarmé), lequel, vide, s’encombre encore trop. Étrange cénotaphe
grouillant de si beaux corps — en travers de quoi j’inscris une cicatrice fugace,
un tatouage tenace, un passage encore pseudo mais réel parce que pseudo.
Je peux bien découper le même livre (plusieurs exemplaires matériellement
identiques d’un même livre), à chaque fois, que je le veuille ou
non, la découpe sera différente. Ainsi le « Discours
de l’Améthode » (Des cartes, 16 exemplaires juxtaposés
en carré.)
L’art permutationnel institue un faux labyrinthe (répertoire d’éléments
x loi-opération, perturbations réglées, pseudo-hasard des
suites cycliques). Ici c’est la répétition impure qui produit
la différence.
Le fantasme se montre comme scénario, aspect mi-diurne mi-nocturne d’un
dispositif oscillant de l’énergie au signe, puissance figurale.
PORNOGRAPHIE
Mes premières agressions contre le livre (1971) relèvent de la
névrose. Par ex., « 12 accès au Cambodge par la Voix
Royale », avec une incision vaginoïde dans 12 exemplaires d’un
roman d’André Malraux.
Puis la découpe devint géométrique (trait de coupe horizontaux
et verticaux) et calculée. Maintenant, le trait de coupe (déterminé
par le choix du texte comme avec les « caviardages » )
oblique et courbe alterne (non régulièrement) avec les traits
horizontaux et verticaux.
Si de Bernanos (par ex.) je fais un texte pornographique, il m’est impossible
de découper Sade, sinon — afin que la perversion ne s’arrête pas
— en en banalisant le texte.
Je ne peux découper la littérature qui me répugne et ne
veux entrer dans le menu de cette répugnance.
Mobile — si je pouvais découper ce livre de Michel Butor, ça
signifierait que je n’ai pas écrit La Lange Slave.
W.B. — si un jour je suis mort.
Denis Roche — Quel lamentable con pourrait m’inviter à découper
le Mécrit ?
Maurice Roche — Je découpe compact dans l’amitié. Mais
c’est un cut-up absurde, mon procédé détruisant l’efficacité
d’une autre écriture.
DÉPENSES EN APPAREILLAGE (= DA), —
fin 70, inédit (sauf quelques fragments in « La nouvelles
Poésie française » , de B. Delvaille, Seghers). Écrit
après « Gommages » (=GO).
En fait, écrite sans intention de composer = j’avais noté des
mots, des morceaux de phrases sur des pages. En rouvrant ces pages… j’eus l’idée
de retaper ces notes telles quelles.
![]() GO - L’immobilité
suspecte. D’implicites mandats d’amener contre la fausse absence et la fausse
présence = leur double jeu anéanti en pseudo-surfaces silencieuses.
Traque vide.
GO - L’immobilité
suspecte. D’implicites mandats d’amener contre la fausse absence et la fausse
présence = leur double jeu anéanti en pseudo-surfaces silencieuses.
Traque vide.
![]() DA – Ensemble
de pièces hétéroclites - Self & hétéro-induction
– Dispositif bruyant, qui fraie la pratique du caviardage et sans doute celle
de « La Langue Slave » (LLSL) (Prélèvements
lexicaux et syntaxiques effectués dans des bandes textuelles de mêmes
types). Détraque.
DA – Ensemble
de pièces hétéroclites - Self & hétéro-induction
– Dispositif bruyant, qui fraie la pratique du caviardage et sans doute celle
de « La Langue Slave » (LLSL) (Prélèvements
lexicaux et syntaxiques effectués dans des bandes textuelles de mêmes
types). Détraque.
CE QUI différencie GO et DA c’est une
posture dans le rapport décalé et distordu négation/dépense.
PARADOXIE
GO = accent sur les blancs et les
vides du texte.
HÉTÉRODOXIE
DA = accent sur les articulations et dé-caténations ----
dérapages vide/plein
ADOXIE
L.LSL = transversalité textuelle / figurale après
passage du noir.
NEBEN
Aucun texte n’est découpé pour les mêmes raisons. Comme
le remarquait judicieusement A.B., le même cut-up commence devant la bibliothèque
au moment où la main se pose sur un volume.
Dans le jeu métaphoro-métonymique (citationnel, paragrammatique,
avec toutes les attirances, contaminations et décrochages possibles),
le cut-up affirme la supériorité métonymique, la force
neben.
Mes livres ne sont pas « objets » parce qu’ils ne décident
pas entre le regard et l’œil, et parce qu’ils affirment la puissance hétérogène
du texte.
LIBIDO FONCTIONNAIRE
Quand je découpe mon dernier livre TOIL (8)
je ne fais que me retrouver à chaque mot. Possible cependant
que TOIL découpé soit vu et lu autrement. (Dissymétrie
production/consommation dans la dissymétrie historique des sujets). En
fait, plutôt une régression.
EMBALLAGE PLASTIQUE
Distance et proximité du produit dans la parodie d’une barre. (Dans toute
cette bibliothèque perdue, un seul livre où un filet translucide
de colle unit l’emballage plastique au texte. — J’ai donné ce livre).
BONNES POUR LES PORCS (diversion politique)
Ma perversion (je préfère déversion — et diversion même
— ou aversion) de textes respectivement érotiques et politiques efface
le temps fort (le temps substantif qui fait thème et exclusion), trouve
le signifiant dans « l’insignifiance », l’instant dans
l’instance, joue la relation contre l’axiome, la valence contre la définition,
la figure aux dépens du graphe. Découverte primaire, vraiment
pratique, que la politique est l’érotique. Et réciproquement.
On ne nie pas la posture axiomatique. On l’empêche d’instaurer la théologie
politique. L’Art qui, en un (seul) sens, serait le contraire de la logique,
n’est pas le contraire de la Politique. Il en figure les pertes et la perte.
(MÉDIATION)
Même la médiation existe – dans la logique moyenne de
l’impuissance économique politique (figure étatique de la stase
kitsch générale). L’Art se situerait alors quelque nulle part,
« entre » la médiation et la répétition.
« … et que la répétition est proprement ce qu’on a
appelé par erreur la médiation. » Dommage que Kierkegaard
ne mange que le cœur de la salade, les feuilles étant « bonnes
pour les porcs » .
COLLAGES
Ce qui avait été dissimulé au profit de la machinerie slave
(papier, couleur, dans tous leurs aspects matériels) fait retour.
Les 20 cartes mobiles de La Langue Slave développaient un hyperidéogramme
sans commencement ni fin mais susceptible de détournement latéraux
sans limite.
En juxtaposant symétriquement (en carré ou en rectangle) 16 (ou
24, etc.) exemplaire d’une même carte tirée du jeu de L.L.SL,
j’espère un branchement rationnel / permutationnel.
Pour désapproprier à nouveau, et dévertir la combinatoire,
j’indique quelques possibilités (car elles sont presque innombrables)
:
- Sur un carré de 16 cartes identiques, et pouvant le déborder,
sont disséminés (aléatoirement ou non) et surcollés
4 morceaux de mêmes dimensions d’une 17e carte identique (divisée
en 4 rectangles selon les médianes).
- Ajout analogue à partir d’une carte dépareillée : (a)
ajout à l’intérieur du carré, (b) dans la marge (le carré
étant collé sur un support blanc ou ocre qui le déborde).
- Ajout à partir d’un autre texte.
- Ajout de papier (sans texte).
- Ajout de peinture, de crayon de couleur (aléatoirement, non aléatoirement,
plus ou moins aléatoirement).
- Omission d’une série horizontale (= 4 cartes identiques, si on a un
carré de 16) remplacé par du bristol blanc ou quadrillé
(pouvant recevoir un ajout de texte, de peinture, etc.).
- jeu du collage comme ensemble et de sa marge matérielle (renversement
ininterrompu périphérie/centre, exploration systématique/erratique
du sens et du neutre, de leur impossibilité et scandale, mécanismes
du leurre saisi dans leur processus impur sans double-fond, jeu sans fin de
la signature et de l’excès, fatigue du pouvoir et dérive impersonnelle.).
TOILÉS, GRATTÉS, REPEINTS, CARTOUCHE À BLANC
Ouvertures régulières pratiquées dans du carton toilé,
dégageant le carton sous la toile. Le carton peut être encore gratté,
partiellement repeint, etc. on peut combiner la découpe avec la photo,
Le livre (dont toutes les pages sont collées). Décollage, surcollage,
cartouche vide.
Pratique (réglée/déréglée) délocalisante.
Métonymie généralisée. (9) qui subvertit toute l’éthico-esthétique
du texte français moyen.
Ici, l’esthétique forte est aussi l’éthique neben.
PAPIER / PAPIER
Mes collages — où le texte avait disparu.
Cartes blanches assemblées. Papiers surcollés / déchirés.
Déchirures, arrachures a- et symétriques. Ajout de peinture. Puis
de nouveau ajout de texte — réeffacé. Etc. (Tel fut le dernier
mot de Scène d’Ob).
PAPIER PEINT
Pas seulement la peinture comme ajout mais imprégnation générale
du support. La marge disparaît, on n’est plus situable. Peinture acrylique
= blanc/gris (ici passe toute l’écriture et la mythologie de TOIL, quant
au gris)/mauvais rose. Et dans tout ce papier le flux déplacé
de ma toile, la peinture défaite dans la peinture. (10)
Le jeu neben infra-&-polyphonique & chromatique est jeu AVEC, SUR, DANS,
À TRAVERS, LE LONG, etc. pas seulement fort / da mais fort du fort &
da du da (quelque chose qui saisit le dispositif, collusion rythmique du hardware
et du software.)
LE DÉTAIL
… procède, certes, de lois, mais les menace, dans leur promotion même.
Drame du réseau et de l’affect, trans – et déversion.
N.B. Il est probable que sans l’invention du crayon feutre et du cutter, je ne serais pas mêlé à des histoires pareilles.
CATALOGOS
TOIL (9) = page 136,149-50, 161,
172, 176, 243, 249, 289-90-1.
MV le 15 novembre 1975
RESTE/DÉCHET (Bibliographie ou quinconce).
L’espace indien (Butor-colloque de Cerisy 1973-10/18) – L’insupportable
et l’amusement (préface à l’exposition J-L Parant – Théâtre
Oblique 1975) – Sur Cremonini
(critique Nov 75 - Mort en RFA (Succon, automne 1975) – Pourtraitures
(Exposition MV – Théâtre Oblique – 1975)
(1) Hameaux Stratégiques, Quaternaire, 1968 — Repris dans Amulettes
Maigres, Pierre-Jean Oswald.
(2) Gommages, Encres Vives, automne-hiver 1970.
(3) Scène d’Ob, Bibliothèque Phantomas, Bruxelles (terminé
en avril 1968).
(4) Encres Vives, Coll. Manuscrits, 1971 — Les épigrammes plates de « Gommages »
sont réinsérées dans la presse d’où elles avaient
été prélevées — (Délocalisation, déplacement.).
(5) Caviardages, Collection Génération, 1972 (terminé fin
71).
(6) Minuit n°3, mars 1973, « Cuirs et peaux papier »,
à partir de la collection « Que Sais-je » .
(7) Neben, 1973.
(8) Christian Bourgois 1975.
(9) « Cadres orginaux » en donne une idée un peu
livresque — Bande dessinée parue dans Minuit n°5, sept.73.
(10) Pourtraitures, catalogue de mon exposition au Théâtre Oblique,
nov.75.
* anagramme de LA LANGUE SLAVE (ndr)
A.B. : Alain Borer